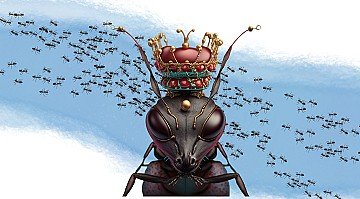Article rédigé par COLETTE DENIS
Enseignante-chercheuse en Physiologie Animale, Université Paul Sabatier- Toulouse 3/ INSERM UMR1297, Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires, équipe RFLab, Toulouse.La recherche biomédicale vise à comprendre le fonctionnement, normal ou pathologique, du corps humain, afin d’améliorer la santé et la qualité de vie des individus. Que ce soit dans son volet clinique ou dans le domaine fondamental, elle s’est souvent cantonnée à des études sur des individus masculins sans tenir compte du fait que la prévalence de certaines maladies diffère selon le genre. On s’aperçoit aussi que de nombreux stéréotypes de genre circulent toujours en médecine et même en physiologie expérimentale. L’existence de ces idées reçues est-elle aussi anodine qu’il parait ?
Sexe et genre, quelques définitions.
Sexe : caractéristiques biologiques qui différencient les hommes des femmes, comme les organes reproducteurs, les chromosomes sexuels, les hormones.
Genre : rôles qui sont déterminés socialement, comportements, activités et attributs qu’une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes.
En santé humaine: sexe et genre sont en interaction permanente.
En recherche sur les animaux de laboratoire ou les cellules en culture: on considère le sexe uniquement.
NB : Certaines personnes sont intersexuées, car leur biologie ne correspond pas totalement aux définitions binaires du masculin et du féminin. Environ 35 causes différentes d’intersexuation ont été décrites. Cela concerne au moins 1.7% des naissances, et on compte plus d’un million de personnes intersexuées en France.
Ouvrons un livre de physiologie humaine et nous verrons très vite qu’en physiologie comme en langue française, le masculin l’emporte sur le féminin. De nombreuses données chiffrées citées dans les différents chapitres, concernent un mythique individu, en général nommé « homme de 70 kg ». Ainsi on estime que ce qui est connu chez l’individu masculin s’appliquera également à un individu féminin, avec quelques ajustements liés au poids par exemple.
La science biomédicale n’a souvent accordé une réelle attention aux femmes que dans le domaine de la reproduction, ce qui a donné l’expression de « médecine-bikini » pour caractériser cette focalisation sur leurs seuls seins et organes reproducteurs.
Mais même dans ce domaine, des tabous restent ancrés. On pense par exemple à l’endométriose relativement peu étudiée en laboratoire jusqu’à récemment, reconnue par l’Assemblée Nationale comme Affection de Longue Durée seulement en janvier 2022, alors qu’elle touche environ 10% des femmes (1).
Les maladies ont-elles un genre ?
Depuis longtemps, il est établi que certaines pathologies surviennent plus fréquemment dans un genre que dans l’autre. Par exemple, la maladie d’Alzheimer, les maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde, les pathologies thyroïdiennes, le lupus érythémateux et le Covid long, touchent plus souvent les femmes que les hommes. Inversement les hommes sont plus fréquemment atteints de goutte, d’ulcère duodénal, de maladie de Parkinson, de pancréatite aigüe, de trouble du spectre autistique.
Concernant les troubles du spectre autistique (TSA), on décrit classiquement 4 à 5 garçons atteints pour 1 fille, mais il est probable que ce ratio soit erroné en raison d’un sous-diagnostic ou d’un diagnostic plus tardif des filles. Des études montrent que les outils de diagnostic ont été établis chez les garçons, or les filles peuvent avoir une expression différentielle de la pathologie et sont connues pour compenser davantage. Et n’aurait-on pas tendance à moins s’inquiéter lorsqu’une petite fille est plus en retrait des interactions sociales que lorsqu’il s’agit d’un garçon ? (2)
Le personnel soignant mais aussi les patientes et patients sont influencés par les stéréotypes sociaux et culturels du masculin et du féminin, ce qui peut induire des diagnostics biaisés ou des retards de prise en charge.
Par exemple, l’ostéoporose est typiquement considérée comme une maladie de femme de plus de 50 ans. S’il est vrai que la masse osseuse diminue chez les femmes après la ménopause, les hommes perdent aussi du capital osseux en vieillissant. Mais ils ont moins de chance d’être évalués ou de recevoir un traitement spécifique après une fracture, ce qui fait que la mortalité après fracture osseuse sévère est plus élevée chez les hommes que chez les femmes.
Inversement, l’infarctus est souvent associé à l’image d’un homme de plus de 50 ans. Or les maladies cardiovasculaires sont aujourd’hui la première cause de mortalité chez les femmes ! Elles meurent plus souvent que les hommes des suites d’un infarctus parce qu’elles ne reconnaissent pas les signes, qui peuvent être atypiques, ou ont tendance à minimiser les symptômes. (3)
Plusieurs rapports démontrent également que les situations économiques et sociales jouent un rôle défavorable sur la santé des femmes (Billon et Laborde, 2015 ; Coutelle et Quéré, 2015 ; Bousquet et al., 2017). Plus exposées à la précarité, à la monoparentalité, aux violences conjugales, elles sont fragilisées vis-à-vis de certaines maladies.
Des progrès certains mais toujours un déficit de femmes dans certains essais cliniques.
La recherche clinique a souvent exclu les femmes, en particulier dans les essais thérapeutiques sur les médicaments, pour éviter les risques liés à une éventuelle maternité. Cela a créé des incertitudes dans les dosages des médicaments et la détection des effets secondaires, augmentant le risque d’effets indésirables chez les femmes par rapport aux hommes (Zucker and Prendergast, 2020).
Ce déséquilibre de genre dans les essais cliniques a été pris à bras le corps dès les années 1990 aux Etats-Unis par le NIH (National Institutes of Health) qui a développé une forte politique incitative. Elle a porté ses fruits puisque globalement, aujourd’hui, les femmes sont à part égale des hommes dans les études portant sur les nouveaux candidats médicaments. Cependant, la logique voudrait que le ratio femmes/hommes dans les essais cliniques reflète le ratio de sexe des patients atteints de la maladie. Or ce n’est toujours pas le cas dans le domaine des maladies cardiovasculaires et infectieuses où les femmes sont sous-représentées (Vasisht et al, 2021).
La recherche fondamentale et préclinique est-elle plus sensible au sexe des modèles ? Allons voir si cette variable est prise en compte dans les expériences menées dans les laboratoires.
Des souris femelles injustement sous-représentées
Plusieurs analyses de la littérature scientifique en biologie ont démontré que les animaux mâles (souris dans la majorité des cas) sont utilisés préférentiellement aux animaux femelles pour la plupart des recherches en dehors du domaine de la reproduction (Beery and Zucker, 2011 ; Yoon et al, 2014).
Pourtant lorsqu’on mène des travaux sur des souris mâles et femelles, les résultats montrent que ce que l’on décrit chez l’animal mâle n’est pas forcément exact chez l’animal femelle, et inversement.
Par exemple, dans le domaine des maladies métaboliques, comme le diabète ou l’obésité, certains régimes ou traitements utilisés couramment sur des animaux mâles pour qu’ils développent la pathologie sont peu ou pas efficaces chez les femelles. C’est une des raisons invoquée pour ne pas utiliser les femelles dans les études ces maladies. Or les femmes sont pourtant largement victimes de ces pathologies et chercher des nouveaux modèles expérimentaux pertinents chez les femelles serait une nécessité.
Un autre frein à l’utilisation des femelles est l’existence des cycles hormonaux. De nombreux scientifiques sont persuadés que ces variations hormonales induiront une plus grande variabilité des résultats, même lorsqu’on travaille sur des fonctions non liées à la reproduction. Or ce dogme a été déboulonné par plusieurs analyses de la littérature scientifique, reprenant des résultats obtenus sur des milliers d’animaux, qui démontrent que la variabilité n’est pas plus grande chez les animaux femelles que mâles (Prendergast et al, 2014 ; Kaluve et al, 2022).
Les hormones « femelles » ont bon dos
Toutes les hormones sont sujettes à des variations de leurs taux, essentiellement à cause de rythmes biologiques. Par ailleurs, la notion d’hormones mâles vs femelles, clairement différentes, doit être nuancée : aucune hormone n’est spécifique d’un seul sexe.
Même les cellules ont un sexe
Les cellules en culture utilisées en recherche sont issues d’organismes vivants, animaux ou humains et sont porteurs des chromosomes de l’organisme donneur. Or, mâles et femelles n’ont pas les mêmes chromosomes. Dans l’espèce humaine nous possédons 23 paires de chromosomes, la moitié est reçue de notre mère, l’autre moitié de notre père. 22 paires sont appelées les autosomes et la 23ème paire est la paire de chromosome sexuel XX (conférant le sexe biologique féminin) ou XY (conférant le sexe biologique masculin). D’autres formules chromosomiques sont possibles et se traduisent par un phénotype dit intersexe.
Les chromosomes sexuels sont très différents par leur taille, le Y est 2,5 fois plus petit que le X et contient 10 fois moins de gènes. C’est lui qui permet la différenciation testiculaire et l’apparition du phénotype male. Le X code pour des protéines assurant de très nombreuses fonctions cellulaires qui ont souvent été découvertes par des mutations entraînant certaines pathologies dites « liées à l’X ». Les principales fonctions de ces gènes sont résumées sur l’illustration « Fonctions de X et de Y ».
Cette distinction génétique due aux chromosomes sexuels peut contribuer aux différences observées entre organismes mâles et femelles. Il a été montré dans de nombreux cas que les réponses biologiques varient selon le sexe chromosomique de la cellule étudiée. Or beaucoup de scientifiques ne mentionnent toujours pas le sexe des cellules utilisées.
Des progrès certains mais encore perfectibles en physiologie cellulaire.
Quelques points pour conclure (5 à 8)
Même la recherche fondamentale n’est pas exempte de biais puisqu’encore aujourd’hui de nombreux scientifiques choisissent d’ignorer la variable sexe dans leurs protocoles et de n’utiliser que des animaux mâles. Or, l’organisme femelle n’est pas un organisme mâle en miniature. Lorsque les recherches sont effectuées sur les 2 sexes les résultats présentent quasi-systématiquement des différences. Les organismes financeurs de la recherche au niveau européen et national sont maintenant sensibilisés à ce problème et développent des politiques incitatives.
En santé humaine, il reste aussi essentiel de bien prendre en compte la dimension du genre et de toutes ses composantes, sociales, économiques et culturelles pour réduire les inégalités de santé, malheureusement réelles (4).
En biologie comme dans de nombreuses autres disciplines scientifiques, il sera important de prendre conscience du fossé des