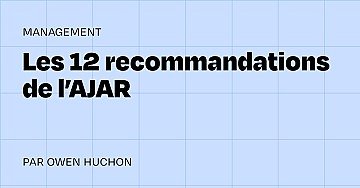Avec Bakou pour théâtre lors de cette édition 2024, la COP29 a rejoué un scénario désormais familier. En accueillant l'événement dans sa capitale, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s'est placé sous les projecteurs internationaux, s'exposant du même coup aux regards scrutateurs des ONG, associations et militant·es qui n'ont pas manqué de mettre en lumière le sort déplorable réservé aux journalistes et aux opposant·es politiques de l'hôte, fermement attaché au pétrole et au gaz. En 2023 lors de la COP28, Dubaï concentrait également les critiques sur le non-respect de bon nombre de droits fondamentaux malgré l'ambition des Émirats arabes unis de redorer leur image, écornée par leur dépendance au pétrole et les dérives autoritaires de ses dirigeants. Mais au-delà des critiques adressées à l’hôte, c’est le format même des COP qui est remis en question. Année après année, ces événements sont raillés pour leurs lacunes et cette dernière édition n’aura pas dérogé à la règle. Certain·es feront valoir que le rendez-vous était caduc d’avance, difficile de leur donner tort. Entre les résultats décevants, les politiques déplorables à l’égard du droit de la presse et l'instrumentalisation de l’événement au service d’un pays hôte en déficit d’image, certains médias s’interrogent… Que vont-ils bien faire dans cette galère ? Une interrogation qui résonne particulièrement au sein d'une presse indépendante fermement attachée à ses principes et valeurs écologiques.
J’y vais, j’y vais pas
Si la plupart des rédactions s’accordent sur le fait que la COP reste un événement majeur de l’actualité environnementale, les avis divergent sur les moyens à déployer pour couvrir ces deux semaines d’intenses tractations. Avant de se rendre sur place, certaines rédactions pèsent prudemment le pour et le contre. Pour cette édition, la rédaction du média indépendant Vert a tranché. Bien que présente à Dubaï pour la COP28, la rédaction a estimé cette fois-ci que le déplacement ne s’imposait pas. Pourtant, sur le plateau d’Arrêt sur images l’an passé, sa présidente Juliette Quef considérait que « même si on doit prendre l’avion, c’est important en tant que journaliste qu’on soit sur place. On ne raconte pas la même chose ». La décision de n’y pas s’y rendre cette année ne constitue pas un revirement, nous assure-t-elle : « On n'a pas changé d'avis, on est tout à fait sur la même ligne. Pour nous, ce qu'il faut se demander avant d'envoyer un·e journaliste c'est : qu'est-ce qui va être discuté ? Chaque COP n'a pas la même importance ».
En somme : se déplacer et prendre l’avion si nécessaire, mais pas pour n’importe quoi. Si la rédaction prend en compte l’impact environnemental et économique de son déplacement, c’est l’aspect éditorial qui prime précise Juliette Quef. Lors de cette dernière édition, le média a considéré qu’il n’en valait pas la peine d'un point de vue journalistique et ne regrette pas sa décision : « Les négociations patinent totalement (...) Il n’y a pas beaucoup de chefs d’État et le gouvernement français n’y est pas. En réalité, ce n’est pas une COP majeure » conclut-elle. Vert n’est pas seul dans ce choix. Mickael Correia, journaliste pour Mediapart, avait décidé l’année dernière qu’il ne mettrait pas un pied à Dubaï. Sur le plateau d’À l’air libre, l’émission de Mediapart, il énumérait les raisons derrière sa décision : bâillonnement de la presse, dérives autoritaires, risque de cautionner une stratégie de greenwashing… « À quoi ça sert de brûler autant de carbone pour suivre des discussions, dans un parc expo' ultra sécurisé, que je peux suivre en vidéo ? », s'interrogeait-il.
De son côté, la rédaction de Reporterre a envoyé un journaliste de sa rédaction, Emmanuel Clévenot, pour couvrir l’événement sur place [la personne interviewée est une connaissance proche de l’auteur. Plus d'informations dans notre note de transparence, NDLR]. Il identifie un certain nombre de limites dans l’exercice d’un travail à distance qui pourraient potentiellement appauvrir la valeur éditoriale de leurs contenus, en passant notamment à côté de certaines paroles clés : « Le sens premier du métier de journaliste, c'est d'aller chercher l'information là où elle est. Ce travail-là, on ne peut pas le faire correctement depuis Paris, où on travaille uniquement en desk, à partir des dépêches AFP ou en passant quelques coups de téléphone. On va appeler des personnes qu'on connaît, qu'on a déjà identifiées. On ne va pas être ouvert à discuter avec de nouvelles personnes qu'on pourrait rencontrer sur place ». Mais les journalistes sont-ils véritablement libres d'interagir avec n’importe quelle source quand on connaît le dédain des autorités locales pour les droits élémentaires de la presse ? « On a bien conscience qu'en termes de liberté de la presse, on n'est pas du tout au même niveau qu'en France », admet le journaliste, se référant au classement de Reporter sans frontières qui attribue à l'Azerbaïdjan la 164e place sur 180. Véronique Rebeyrotte, journaliste qui a couvert l’événement sur place pour France Culture, y a constaté durant son séjour une négligence évidente pour le droit de la presse, témoignant d'une surveillance permanente de ses activités ainsi que celle de ses confrères et consœurs au fil de ces deux semaines. Des pratiques alarmantes qui peuvent sensiblement nuire à leur travail : « Ne va-t-il pas y avoir des répercussions sur les personnes de la société civile que l'on va interviewer ? » s’interroge-t-elle au micro de France Culture. « Il y a une forme d'autocensure, il faut bien le reconnaître ».
Se déplacer différemment
Si l’ironie d'emprunter des jets privés pour se rendre à la COP échappe à certain·es PDG et stars, des médias réfléchissent à des solutions plus cohérentes pour leurs déplacements. Pour limiter son bilan carbone, Reporterre a fait le choix de faire le trajet jusqu’à la capitale azerbaïdjanaise en train. Un voyage de neuf jours, qu'a raconté quotidiennement le journaliste à travers des vidéos et des articles, à sillonner les chemins de fer et gares ferroviaires de l’Europe de l’Est… ainsi que les halls d'un aéroport géorgien. Car pour l’aller, la rédaction a été confrontée à un pépin. Entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan, impossible de traverser la frontière par voie terrestre selon l'ambassade de France à Bakou ; un détour par le tarmac s’est donc avéré inévitable. Un vol d’une heure, entre les capitales respectives des deux nations. « Malgré tout, cette option d’un trajet très majoritairement en train couplé d’un peu de bus et un vol à la fin devrait représenter une empreinte carbone quatre fois inférieure à celle qu'on aurait eue si on avait fait tout le voyage uniquement en avion », nous affirme Emmanuel Clévenot. Pour le retour, le journaliste est rentré par ses propres moyens « pour voyager », sans prendre l'avion nous confirmera-t-il, mis à part pour quitter le territoire azerbaïdjanais comme à l'aller.
L'exercice représente une organisation logistique conséquente. Envoyer un·e journaliste couvrir un événement avec un trajet de neuf jours reste hors de portée pour de nombreuses rédactions indépendantes. Au risque de flirter avec la démagogie ? Emmanuel Clévenot s’en défend : « L'idée n’est pas du tout d'aller pointer du doigt les autres journalistes, les scientifiques ou les ONG qui ne feraient pas cette démarche-là ». À travers cette initiative, le journaliste de Reporterre assure au contraire vouloir mettre en lumière la pénibilité du trajet et un déficit d'infrastructure qui empêchent au plus grand nombre de se passer de l'avion précise-t-il : « C'est aussi un appel à développer les mobilités douces ».
Une initiative que salue Juliette Quef, pour qui l'exercice représente une occasion de raconter différemment le voyage, tout en soulignant l’importance de ne pas imposer des standards inatteignables : « Il ne faut pas qu'on soit dans une pureté militante sinon on a tous·tes perdu. C'est pas grave s'il doit prendre l'avion sur la dernière étape. Ça reste une expérience intéressante, même s'il prend l'avion au retour. Je ne voudrais pas que ça contribue à imposer des choses impossibles pour des journalistes ou des petites rédactions qui ont une réalité différente ». Parmi les recommandations énumérées dans la Charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, initiée par Vert et signée par de nombreuses rédactions, figure notamment l'importance de « cultiver la coopération ». Un levier clé pour limiter les émissions carbones lors de déplacements, notamment dans le cas où l’avion s’avère indispensable, avance Juliette Quef : « Pour faire un Paris-Nice, les rédactions ne devraient plus prendre l'avion, c'est évident. Si on veut aller dans les pays voisins, on peut essayer de s'organiser pour prendre le temps de collaborer entre médias, entre journalistes, pour mutualiser certains moyens, au lieu d'y aller à trois rédactions différentes ». Une stratégie « une pierre deux coups » esquissée lors de la dernière COP à Dubaï durant laquelle Vert avait produit une chronique hebdomadaire pour la Terre au carré, émission de France Inter, et qu’assure cette année Reporterre. Autre solution : employer des pigistes. L’année dernière, Reporterre avait fait appel aux services du journaliste Valéry Laramée de Tannenberg qui avait déjà prévu de faire le déplacement pour une autre rédaction. Un choix que pourrait privilégier le média pour la prochaine COP, qui se tiendra au Brésil. « Le plus probable c'est qu'on travaille avec un ou une pigiste du Brésil parce qu'on en connaît et qu'on travaille déjà avec eux·elles » explique Emmanuel Clévenot.
Couvrir l’événement différemment
Les COP concentrent régulièrement des critiques. Moqué pour son inefficacité, raillé pour son dysfonctionnement, critiqué pour l'attribution de ses hôtes. La COP n’a pas bon dos et la complexité des tractations qui rythment ce théâtre diplomatique n’aide pas. Mais plutôt que de les décrypter et d’accompagner le public à travers cet évènement, certains médias préfèrent s’intéresser aux déboires bien plus sensationnels. Pourquoi perdre du temps à ressasser sur les aspects techniques — pourtant cruciaux — du dossier en jeu quand on peut montrer des images d'une station de ski en intérieur en plein Dubaï qui feront à coup sûr réagir ? « C’est notre travail de journaliste et c'est sûr que c'est plus dur » observe Juliette Quef. « C'est de réussir à adresser des enjeux complexes qui, de base, sont très pénibles et à rendre ça plus simple ». Un défi qui repose sur un effort d’analyse et de vulgarisation afin de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre, mais aussi sur le choix des formats employés. « Si on fait passer ça à travers des articles uniquement de décryptage très lourd, on va parler à trois personnes », estime-t-elle. Une démarche qui se traduit notamment par la création de vidéos incarnées pour les réseaux sociaux de Vert, diffusées sur Instagram ou TikTok, ou encore par le recours au dessin de presse.
Même son de cloche du côté de Reporterre, pour qui la vulgarisation constitue une caractéristique essentielle de leur couverture de l’événement. La rédaction entend également travailler sur ce rendez-vous diplomatique différemment, en portant notamment un discours alternatif. Emmanuel Clévenot estime que sa présence sur place lui permet d’assurer la présence d’une voix différente sur ces enjeux : « On considère qu’un média spécialisé sur l’écologie, comme Reporterre, se doit d’aller raconter ces événements-là, ne serait-ce que pour porter un regard qui diffère d’autres médias généralistes qui auront peut-être une vision un peu moins radicale que Reporterre sur les décisions et les discours ». Un aspect indispensable de leur couverture médiatique de l’événement afin de s’affranchir d’un risque de devenir acteur de la stratégie de communication de pays hôte : « J'y vais pour raconter ce qui se passe. Et la façon dont je vais le raconter ne va en rien cautionner ce qui se passe là-bas », assure-t-il.
S’écouter et écouter ses lecteur·ices
« Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter » rappelle ponctuellement Mediapart, qui a fait de ce slogan le gage de leur indépendance et le symbole de son attachement à une pérennité économique acquise grâce au soutien d’une communauté convaincue de la valeur d’une presse indépendante. Une formule quelque peu pince-sans-rire mais pleine de sens à bien des égards. À l’instar d’investisseur·euses fortuné·es mécontent·es des résultats d’une entreprise, les lecteur·ices peuvent choisir de partir avec leur portefeuille, pourtant essentiel à la survie du média, s’ils·elles n’y trouvent pas leur compte. Pour Vert et Reporterre, qui reposent principalement sur les dons, les contributions de leurs donateur·ices ne se limitent pas qu’à un simple soutien financier. Derrière ce geste, ils et elles expriment un désir de renforcer et promouvoir des valeurs, des pratiques et un discours alignés avec leurs convictions écologiques. Plus qu’une simple transaction, cet acte traduit un véritable engagement et une confiance envers le média qu’ils·elles soutiennent. Une confiance à ne pas trahir, comme le souligne Emmanuel Clévenot : « Évidemment que nous sommes attendu·es par nos lecteur·ices et par nos confrères et consœurs d'autres journaux pour ne pas faire n'importe quoi. Évidemment que ça serait complètement absurde et contradictoire si demain Reporterre se mettait à faire des voyages aux quatre coins du monde ». Au-delà de simplement concilier les attentes des lecteur·ices avec les choix stratégiques et éditoriaux du média, l’intérêt de Reporterre pour la mobilité douce découle tout simplement de convictions personnelles qui traversent les journalistes de la rédaction, quotidiennement amené·es à travailler sur l’impact de la pollution : « Ça finit par dépasser ton propre métier, ta propre fonction de journaliste. Nous sommes convaincu·es aujourd'hui, en tant qu'individus, que prendre l'avion au quotidien, c'est plus possible ».
Pour Vert, il paraît ainsi essentiel de donner à leurs soutiens une voix au chapitre et un véritable sens à leur engagement aux côtés du média qu’ils soutiennent. Afin de matérialiser cet engagement, la rédaction a créé le Club de Vert que ses soutiens peuvent rejoindre en faisant un don. Parmi ses avantages, le Club permet aux membres de donner leur avis sur des choix stratégiques du média. Vert avait par exemple proposé à ses membres de voter sur leur collaborat